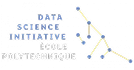CICo
Crédit d’Impôt en faveur de la Recherche Collaborative
Valorisez jusqu’à 50 % de vos dépenses de R&D partenariale
- Rémunération uniquement au succès
- Accompagnement global : audit, contrat, justification, déclaration
- Dossiers CICo sécurisés par nos experts en fiscalité et partenariats scientifiques
- Partenaire des entreprises innovantes sur toute la France

Un premier échange pour comprendre votre projet, qualifier votre partenariat et estimer votre potentiel CICo.

Qu’est-ce que le Crédit Impôt Recherche Collaborative ?
Le CICo, ou Crédit d’Impôt en faveur de la Recherche Collaborative, est un dispositif fiscal destiné à soutenir les entreprises qui mènent des projets de R&D en partenariat réel avec des organismes de recherche publics ou privés agréés.
Créé en 2022 dans le cadre d’une refonte plus large des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et de l’innovation, il a remplacé l’ancien doublement d’assiette du CIR pour les dépenses sous‑traitées à la recherche publique. Cette réforme a pour objectif de privilégier des collaborations scientifiques structurées plutôt que de simples prestations externalisées.
Le CICo vise ainsi à renforcer les liens entre recherche publique et secteur privé tout en stimulant l’innovation en France, en encourageant des projets collaboratifs porteurs de valeur scientifique et économique.
- Le CIR finance les projets de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale, qu’ils soient réalisés en interne ou confiés à des prestataires agréés.
- Le CII cible exclusivement les PME développant des produits innovants, sans nécessiter de travaux de R&D au sens strict.
- Le CICo, quant à lui, valorise les projets de recherche menés en collaboration effective avec un organisme public ou privé agréé, dans le cadre d’un contrat équilibré.
Quel est le montant du CICo accordé ?
Le montant du CICo dépend directement des dépenses facturées par l’organisme de recherche partenaire dans le cadre du projet collaboratif. L’assiette retenue correspond aux montants engagés par l’entreprise auprès de l’ORDC, dans la limite d’un plafond annuel de 6 millions d’euros par entreprise. Au-delà de ce seuil, les dépenses supplémentaires ne sont plus prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Le taux du CICo varie selon la taille de l’entreprise. Il s’élève à 50 % pour les PME au sens communautaire, c’est-à-dire les structures de moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les autres entreprises (ETI, grandes entreprises), le taux est fixé à 40 %.
Il est important de noter que le CICo n’est pas cumulable avec le CIR pour les mêmes dépenses. Si un même projet fait l’objet de plusieurs types de financement, une séparation rigoureuse des assiettes est exigée. En revanche, le CICo peut coexister avec d’autres aides publiques (régionales, nationales ou européennes), à condition que les règles de plafonnement et de non-cumul soient respectées.


Qui peut bénéficier du Crédit Impôt Recherche Collaborative ?
Le Crédit d’Impôt en faveur de la Recherche Collaborative (CICo) s’adresse à toutes les entreprises, industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, imposées selon un régime réel à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille. Le critère déterminant n’est pas le statut juridique, mais la nature du projet : l’entreprise doit engager une collaboration effective de recherche avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC), public ou privé agréé.
Pour être éligible, la collaboration doit respecter plusieurs conditions strictes : l’entreprise ne doit entretenir aucun lien de dépendance avec l’organisme partenaire, le contrat doit encadrer une co‑construction scientifique, et l’organisme doit conserver la propriété des résultats (avec possibilité pour l’entreprise d’obtenir un droit d’exploitation). L’assiette du CICo correspond aux dépenses facturées par l’ORDC, ce qui exclut les travaux réalisés en interne ou par des prestataires non agréés.
Certaines entreprises sont automatiquement exclues du dispositif : celles soumises à un régime micro-fiscal, celles qui bénéficient d’une exonération totale d’impôt, ou encore celles liées capitalistiquement à leur partenaire de recherche. Une simple prestation externalisée ne suffit pas : seule une collaboration équilibrée, justifiée par un contrat conforme et des échanges documentés, permet d’ouvrir droit au crédit d’impôt.
Quelles sont les dépenses éligibles au CICo ?
Dépenses de personnel et de fonctionnement
Le Crédit d’Impôt en faveur de la Recherche Collaborative (CICo) couvre les dépenses facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d’un contrat de collaboration conforme. Ces dépenses doivent être facturées au coût de revient, sans marge bénéficiaire, et concerner directement les travaux de R&D menés en partenariat.
Elles incluent notamment :
- les coûts de personnel scientifique et technique impliqué dans le projet ;
- les frais de fonctionnement et de laboratoire ;
- les charges indirectes liées à la réalisation effective des travaux de recherche.
Ces coûts doivent correspondre à la conception scientifique du projet collaboratif, et non à de simples prestations techniques exécutées pour le compte de l’entreprise.
Frais liés à la recherche collaborative
Sont également éligibles les dépenses de gestion et de coordination du projet commun : réunions techniques, exploitation de données, essais ou actions de suivi scientifique.
Elles doivent :
- être prévues par le contrat de collaboration,
- figurer sur une facture détaillée émise par l’ORDC,
- être calculées au coût de revient, sans marge, et justifiées par des documents comptables traçables.
Le CICo autorise également la prise en compte des amortissements ou matériels utilisés spécifiquement pour le projet, à condition qu’ils soient facturés au coût réel par l’ORDC.
Dépenses non éligibles à connaître
Ne sont pas éligibles au CICo :
- les coûts internes de l’entreprise, y compris les salaires de ses propres chercheurs ;
- les prestations de sous-traitance technique sans collaboration scientifique réelle ;
- les dépenses liées à des partenaires non agréés ou dépendants (au sens de l’article 39-12 du CGI) ;
- les dépenses financées, même partiellement, par des aides publiques ou subventions ;
- les dépenses facturées au-delà du plafond annuel de 6 millions d’euros, sauf transfert possible vers le CIR.
Toute dépense doit être justifiée, traçable et directement rattachée au projet de recherche collaborative défini dans le contrat, sous le contrôle conjoint de l’entreprise et de l’ORDC.
L’expertise BirdINNOV à votre service
- 1. Analyse de l’éligibilité de votre projet au CICo
- 2. Structuration et validation des partenariats de recherche
- 3. Rédaction et relecture des contrats de collaboration
- 4. Qualification des dépenses et justification technique
- 5. Suivi expert du dossier jusqu’à l’obtention du crédit d’impôt
- Un dossier sécurisé avec un risque minimal de rejet
- Un gain de temps important, grâce à l’externalisation des formalités
- Une optimisation maximale des montants récupérables
- Une tranquillité lors des contrôles fiscaux
- Un accompagnement sur-mesure
BirdINNOV répond à vos questions sur le CICo
Quels partenaires de recherche sont reconnus pour le CICo ?
Pour être éligible au CICo, une entreprise doit collaborer avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) reconnu. Ces partenaires peuvent être publics, comme les universités, les établissements publics scientifiques et techniques (EPST), les écoles d’ingénieurs ou les instituts comme le CNRS, l’INRIA ou l’INSERM. Dans ce cas, l’éligibilité est automatique et ne nécessite aucune démarche particulière.
En revanche, les organismes privés doivent impérativement disposer d’un agrément délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cet agrément, valable pour une ou plusieurs années civiles, atteste de leur capacité à mener des activités de recherche dans un cadre non lucratif et indépendant. Il est possible de vérifier leur statut sur la liste officielle publiée par le MESR, actualisée régulièrement.
L’administration fiscale impose par ailleurs plusieurs critères cumulatifs : l’organisme ne doit pas être lié capitalistiquement à l’entreprise, il doit exercer une activité principale de recherche, ne pas poursuivre de but lucratif, et rendre accessibles les résultats de ses travaux. Ces conditions garantissent que la collaboration s’inscrit dans un cadre scientifique et non commercial. La vigilance est donc essentielle dans le choix du partenaire : un organisme non conforme rend l’ensemble du crédit d’impôt inéligible.
Comment fonctionne la collaboration pour bénéficier du CICo ?
Pour bénéficier du CICo, la collaboration entre l’entreprise et l’organisme de recherche doit être formalisée, équilibrée et effective. Cela commence par la signature d’un contrat de collaboration en bonne et due forme, qui précise la nature du projet de recherche, les objectifs scientifiques, les moyens engagés par chaque partie, la répartition des tâches, les modalités de suivi et de coordination, ainsi que le calendrier des travaux.
L’un des principes clés du dispositif est que la collaboration ne doit pas se réduire à une simple prestation de services. L’entreprise et l’organisme doivent s’impliquer scientifiquement dans le projet : cela implique des échanges réguliers, des contributions croisées, une co-conception des travaux, et un suivi technique commun. En clair, il faut démontrer que la recherche est menée ensemble, et non sous-traitée.
Autre exigence fondamentale : l’organisme de recherche doit conserver la propriété intellectuelle des résultats issus des travaux menés. L’entreprise peut obtenir un droit d’exploitation, mais jamais la titularité. Ce partage des résultats est un critère déterminant, en particulier dans le cas des organismes privés agréés, pour lesquels l’administration vérifie que le projet respecte bien les règles du CICo.
Par ailleurs, l’ORDC doit conserver un droit de publication des travaux menés dans le cadre du projet. Il ne peut y avoir de clause de confidentialité empêchant toute diffusion scientifique, ce qui ferait perdre au partenariat son caractère non lucratif et sa vocation de diffusion des connaissances.
Enfin, l’administration fiscale demande des preuves concrètes de cette collaboration effective. Il ne suffit pas d’avoir un contrat : il faut pouvoir produire des comptes rendus de réunions, des livrables scientifiques, des traces d’échanges techniques, ou encore des plans de travail co-élaborés. Ces éléments seront indispensables en cas de contrôle pour prouver l’existence d’une collaboration réelle, équilibrée et conforme aux exigences du CICo.
Quelle est la durée de validité du dispositif CICo ?
Le CICo est un dispositif temporaire, instauré par la loi de finances pour 2022, et prévu pour s’appliquer aux dépenses de recherche collaborative engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Ce calendrier concerne aussi bien les PME que les grandes entreprises, sans distinction de secteur.
La date à prendre en compte est celle du fait générateur des dépenses, c’est-à-dire la période pendant laquelle les travaux sont réalisés et facturés par l’organisme partenaire. Les entreprises doivent donc veiller à bien rattacher les dépenses à l’exercice fiscal correspondant, et à anticiper la fin du dispositif si elles souhaitent engager un projet éligible.
À ce jour, aucune prorogation officielle n’a été annoncée. Toute éventuelle reconduction ou évolution du dispositif dépendra des décisions législatives à venir et des arbitrages budgétaires du gouvernement.
Quelles sont les démarches pour déclarer le Crédit Impôt Recherche Collaborative ?
La déclaration du CICo suit les mêmes principes que celle du Crédit d’Impôt Recherche, avec quelques spécificités propres. Pour en bénéficier, l’entreprise doit remplir le formulaire fiscal 2069-A-SD, dans lequel une rubrique spécifique est consacrée au CICo. Ce formulaire est à transmettre en même temps que la liasse fiscale, généralement au printemps de l’année suivant la clôture de l’exercice comptable.
Le dossier doit comprendre plusieurs pièces justificatives essentielles : le contrat de collaboration avec l’organisme de recherche, les factures détaillées des prestations réalisées, les preuves de la collaboration effective (réunions, livrables, échanges scientifiques), ainsi que l’attestation d’agrément si l’organisme est privé. L’administration attend une documentation claire, traçable, et conforme à ses exigences.
Si l’entreprise souhaite obtenir un remboursement anticipé de sa créance, elle doit déposer en complément le formulaire 2573-SD. Ce mécanisme est particulièrement utile pour les sociétés en difficulté de trésorerie ou non immédiatement imposables. En cas d’épuisement de la créance CICo, c’est-à-dire lorsque la créance a été totalement imputée sur l’impôt dû ou remboursée, l’entreprise devra suivre son suivi comptable avec rigueur pour éviter toute erreur de déclaration ultérieure.
Le respect des délais de déclaration et la qualité du dossier sont déterminants pour éviter tout rejet ou redressement ultérieur.
Comment sécuriser sa demande de CICo ?
La sécurisation d’un dossier CICo repose sur trois piliers : la conformité juridique, la traçabilité technique et la rigueur documentaire. Le premier écueil à éviter est de confondre collaboration et prestation : un simple contrat de service ne suffit pas. Il faut démontrer une réelle co-construction du projet, une implication scientifique des deux parties, et un partage structuré des contributions.
Les erreurs fréquentes incluent : l’absence de contrat écrit, une relation capitalistique entre l’entreprise et l’organisme partenaire, une facturation imprécise, ou encore la revendication de la propriété intellectuelle par l’entreprise, ce qui est strictement exclu. Ces points sont systématiquement examinés lors d’un contrôle fiscal.
Pour préparer un dossier conforme, il est indispensable de formaliser un contrat clair, de ventiler les dépenses éligibles, de conserver les échanges scientifiques (comptes rendus, mails, livrables techniques), et de rassembler l’ensemble des pièces justificatives dès la clôture de l’exercice. L’objectif : pouvoir démontrer, à tout moment, l’existence d’une collaboration équilibrée, encadrée et documentée.
En cas de contrôle, l’administration vérifiera l’ensemble des éléments : nature du partenariat, rôle de chaque partie, justification des dépenses, indépendance du partenaire, et respect des critères fiscaux. Un dossier mal préparé peut entraîner le retrait total du crédit d’impôt, avec redressement, intérêts de retard et majorations.
Faire appel à un cabinet spécialisé comme BirdINNOV permet de sécuriser chaque étape, de limiter les risques, et de garantir la conformité du dossier face aux exigences de l’administration.
Comment trouver un organisme de recherche agréé ?
Pour identifier un organisme éligible au CICo, il est essentiel de s’assurer qu’il répond au statut d’organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC), tel que défini par l’administration fiscale. Les organismes publics (universités, EPST, écoles d’ingénieurs, etc.) sont reconnus de plein droit, sans démarche particulière.
Pour les organismes privés, il faut impérativement vérifier qu’ils disposent d’un agrément en cours de validité délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). La liste officielle des ORDC agréés est consultable directement sur le site du MESR, avec un moteur de recherche par nom ou numéro SIRET.
Choisir un bon partenaire ne se limite pas à vérifier l’agrément. Il est recommandé d’évaluer la qualité scientifique de l’organisme, sa capacité à collaborer dans un cadre fiscalement sécurisé, sa transparence sur les coûts et son expérience des projets collaboratifs. Un bon ORDC doit être autonome, rigoureux et en mesure de respecter les exigences contractuelles du CICo.
Enfin, pour gagner du temps et éviter toute erreur, il est possible de se faire accompagner par un cabinet spécialisé comme BirdINNOV, qui vous aide à identifier, qualifier et sécuriser les bons partenaires de recherche en fonction de votre secteur et de vos enjeux.